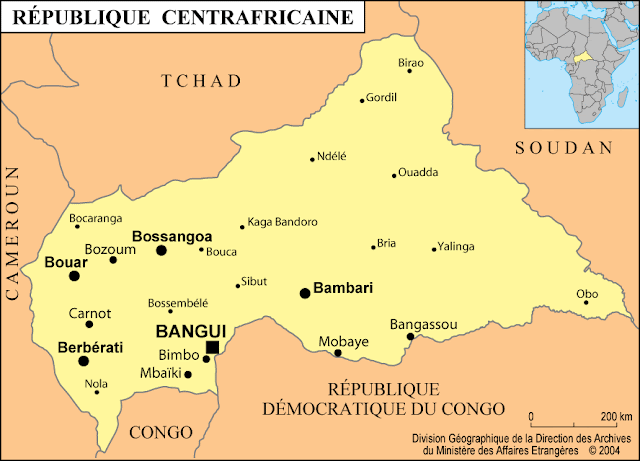République Centrafricaine: Geographie et Histoire
État d'Afrique centrale, la République centrafricaine est limitée au nord-ouest par le Tchad, au nord-est par le Soudan, à l'est par le Soudan du Sud, au sud par la République démocratique du Congo et le Congo, et à l'ouest par le Cameroun.
C'est un pays de forêts et de savanes, où, à côté des cultures vivrières (mil, maïs, manioc), quelques plantations (coton, café) et les diamants (principale richesse du sous-sol avec l'uranium) fournissent l'essentiel des exportations.
Le chaos politique qui dure depuis plusieurs années laisse aujourd'hui le pays exsangue.
 Le milieu naturel
Le milieu naturel
Prolongeant le plateau camerounais de l'Adamaoua, le socle précambrien et des grès secondaires de couverture forment une dorsale de hautes terres aplanies, dominées par des inselbergs rocheux (kaga), se relevant à l'ouest dans le massif de Yadé (mont Ngaoui, 1 420 m) et au nord-est (Dar Fertit, monts des Bongo, 1 400 m). Ces hautes terres alimentent une série de cours d'eau dévalant, au nord, vers la bordure de la cuvette tchadienne et, au sud, vers l'Oubangui et la cuvette congolaise (ex-Zaïre). De régime subéquatorial au sud (1 600 mm), les pluies décroissent vers le nord (7 mois de saison sèche, 900 mm), tandis que s'élèvent les températures (plus de 30 °C). À l'exception d'une zone discontinue de forêt dense dans le Sud, le pays est couvert par la forêt claire ou la savane arborée, qui abritent une faune encore abondante de grands mammifères (éléphants, buffles, antilopes).
La population et l'économie
Il est de tradition d'opposer les « gens du fleuve » et les « gens de la savane », de même que leur culture respective. Il paraît toutefois plus judicieux d'évoquer ce qui rapproche les Centrafricains, tous héritiers d'un lourd et douloureux passé, plutôt que ce qui les divise. Malgré une certaine reprise démographique, la population n'a toujours pas retrouvé son niveau, et de loin, d'il y a trois cents ans. Le dynamisme démographique est d'ailleurs inférieur à la moyenne africaine (à peine 5 enfants par femme), et l'infécondité, phénomène courant dans l'est du pays, semble s'être étendue à d'autres régions. L'Ouest et le Sud, qui représentent la moitié du territoire, accueillent les quatre cinquièmes de la population. C'est là que se situent la capitale et les principales villes secondaires. Le taux de population urbaine, après avoir progressé rapidement dans les années 1960, se serait stabilisé, voire aurait régressé, aux alentours de 40 %, du fait des nombreuses difficultés rencontrées par les habitants de la capitale. Sur le plan religieux, la République centrafricaine se caractérise par une très faible pénétration de l'islam, liée, peut-être, au souvenir du rôle qu'ont joué les musulmans dans la traite des esclaves. Le christianisme domine largement, mais surtout sous la forme d'Églises évangéliques et prophétiques.
 Les aléas de l'histoire n'ont pas permis à l'économie de ce pays enclavé de se développer, malgré certains atouts. L'agriculture est la principale ressource, mais elle reste essentiellement vivrière (manioc, igname, maïs, mil, sorgho, arachide…). L'élevage aurait notablement progressé. Toutes ces activités font l'objet d'un commerce informel actif, y compris avec les pays voisins. Les traditionnelles productions destinées à l'exportation (bois, tabac) sont plutôt en régression (du moins sur le long terme), à l'exception du coton. L'absence d'un réseau routier digne de ce nom explique, pour une part, cette situation.
Les aléas de l'histoire n'ont pas permis à l'économie de ce pays enclavé de se développer, malgré certains atouts. L'agriculture est la principale ressource, mais elle reste essentiellement vivrière (manioc, igname, maïs, mil, sorgho, arachide…). L'élevage aurait notablement progressé. Toutes ces activités font l'objet d'un commerce informel actif, y compris avec les pays voisins. Les traditionnelles productions destinées à l'exportation (bois, tabac) sont plutôt en régression (du moins sur le long terme), à l'exception du coton. L'absence d'un réseau routier digne de ce nom explique, pour une part, cette situation.
L'extraction du diamant et, dans une moindre mesure, celle de l'or sont devenues la principale source de devises du pays. Pour une grande part artisanale, échappant pour partie au contrôle de l'État, elle donne lieu à d'intenses trafics. L'industrie demeure embryonnaire, concentrée à Bangui et tournée vers la seule satisfaction du très étroit marché national. L'appareil d'État, considérablement dégradé, ne subsiste que grâce à une aide extérieure importante, qui représenterait le cinquième du PIB officiel. On ne saurait cependant oublier qu'en République centrafricaine, l'essentiel de l'activité économique échappe à toute investigation.
Les sites de la République centrafricaine classés à l'Unesco
Deux sites de la République centrafricaine sont inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l'Unesco:
– parc national du Manovo-Gounda St Floris;
– trinational de la Sangha.
 |
Bangui - République centrafricaine |
Histoire
L'histoire ancienne de la République Centrafricaine est mal connue et fait encore l'objet de débats entre spécialistes. Il semble cependant acquis, grâce à des découvertes archéologiques récentes, que le peuplement du pays remonte aux temps préhistoriques. Il est, par ailleurs, probable que le pays fut longtemps une terre d'échanges vers le haut Nil et de migrations multiples. Des conditions géographiques favorables firent que le pays prospéra au point d'accueillir sur son territoire actuel, selon certaines estimations, 6 millions d'habitants vers 1700, soit environ le double de la population de la fin du xxe s.
Un pays meurtri
L'absence de grandes structures étatiques va permettre, à partir du xviiie siècle, le développement de la traite des esclaves vers le nord, vers l'est, puis vers l'Atlantique. Cette dernière deviendra peu à peu prépondérante. Le pays est mis en coupe réglée par les Empires qui le bornent (→ Kanem-→ Bornou, Barguirmi, Ouaddaï, Darfour).
Pour en savoir plus, voir l'article esclavage.
Vers la fin du xixe siècle, il est victime de brutales épidémies de variole qui déciment ses habitants et font fuir les survivants. À la même époque, un aventurier d'origine soudanaise, Rabah, entreprend de bâtir un vaste Empire esclavagiste au Tchad et dans le nord du pays. Il est vaincu par les Français en 1900, mais la traite saharienne ne sera définitivement stoppée qu'à la veille de la Première Guerre mondiale.
Les débuts cruels de la colonisation
L'Oubangui, que les Français englobent dans la dénomination « Congo », est la voie de passage obligée vers le nord : sa domination constitue une étape dans la construction de l'Empire colonial français, qui veut joindre, sans discontinuer, Alger, Dakar et Brazzaville. La rivalité coloniale est ici engagée avec le roi des Belges, qui vient de prendre possession de la rive gauche du fleuve Congo. La ville de Bangui est créée en 1889 sur la rivière Oubangui, pour faire face à un poste belge installé peu avant.
Dès cette époque, les populations de la région sont astreintes au portage, pour acheminer le matériel des expéditions françaises successives qui partent à la conquête du Tchad. Certains administrateurs se distinguent par leur brutalité, mais, surtout, le « Congo » dans son ensemble est partagé entre des sociétés concessionnaires exploitant le caoutchouc et l'ivoire, qui se chargent de sa « mise en valeur ». Ce système, générateur de tous les abus, durera, comme le portage, jusqu'aux années 1920.
Entre-temps, l'Oubangui-Chari aura fourni de nombreux soldats à la France au cours de la Première Guerre mondiale. Dans les années qui suivront, il sacrifiera d'autres vies humaines à l'occasion de la construction du chemin de fer Congo-Océan (1921-1934). Excédés, les paysans de l'ouest du pays se révoltent en 1928 : la guerre dite des Gbayas – la plus longue des multiples jacqueries ayant rythmé la vie de la colonie – n'est définitivement matée qu'en 1934, et sa répression n'est toujours pas oubliée.
L'Oubangui-Chari
La délimitation territoriale et le statut de la possession française n'ont pas été définis immédiatement. Ce n'est qu'après l'incident de Fachoda que le Royaume-Uni reconnaît, en mars 1899, la domination de la France sur tout le bassin de l'Oubangui. L'Oubangui-Chari devient une colonie en 1905 puis est intégré dans l'Afrique-Équatoriale française (A-ÉF) lors de sa création en 1910. Mais ses frontières sont modifiées dès 1911 : la France cède à l'Allemagne, comme gage de bonne volonté, l'ouest de la colonie, désormais rattaché au Cameroun allemand.
Cette situation ne dure pas, car la Première Guerre mondiale permet aux Français de récupérer les territoires abandonnés, ce qu'entérine le traité de Versailles en 1919. Le gouverneur Lamblin s'efforce alors de redonner vie au pays – exsangue – avec la construction d'un réseau routier et l'introduction de la culture du coton et de celle du café, avec quelques résultats positifs.
L'Oubangui-Chari se rallie à la France libre en août 1940, en même temps que le Tchad, le Cameroun et le Congo, sans que cela lui vaille la même célébrité. Mais l'effort de guerre qu'on lui demande est bien de même nature.
La décolonisation et l'indépendance
Barthélemy Boganda (1946-1959)
La marche vers l'indépendance, entamée après la fin de la Seconde Guerre mondiale, est marquée par la personnalité de Barthélemy Boganda, le premier prêtre catholique de l'Oubangui-Chari, qui devient territoire d'outre-mer en 1946. Il est élu à l'Assemblée nationale française en 1946, puis réélu en 1951 et en 1956. Fondateur en 1950 du Mouvement pour l'évolution sociale de l'Afrique noire (MESAN), Barthélemy Boganda est un humaniste modéré qui réclame justice et dignité. Il n'en est pas moins en butte à l'hostilité de l'Administration, des colons et de l'Église (qu'il a quittée). Son objectif est la construction d'une nation oubanguienne au sein d'un ensemble plus vaste.
Devenu, à l'unanimité, président du Grand Conseil de l'A-ÉF en 1957, il préconise la constitution d'un État unitaire mais décentralisé avec le Congo et le Tchad, ouvert, de surcroît, à d'autres territoires. Il caresse aussi l'idée d'une Union des États de l'Afrique latine qui associerait les pays des colonies française, belge et portugaise. Ces projets n'entraînant pas l'adhésion de ses partenaires de l'AÉ-F, la République centrafricaine, membre de la Communauté, est proclamée le 1er décembre 1958, après référendum. Barthélemy Boganda ne connaîtra pas l'indépendance totale de son pays : il meurt le 29 mars 1959 dans un accident d'avion dont les circonstances restent mal élucidées.
Son cousin David Dacko, un ancien instituteur, lui succède à la tête du gouvernement et du MESAN, puis est élu président de la République le 13 août 1960, après la proclamation de l'indépendance.
Le pouvoir personnel de David Dacko (1959-1965)
David Dacko se réclame de Barthélemy Boganda, devenu figure légendaire en République centrafricaine, au même titre que celui qui va devenir son principal adversaire, Abel Goumba, leader du Mouvement pour l'évolution de l'Afrique centrale (MEDAC). David Dacko dissout le MEDAC, fait arrêter et juger Abel Goumba, qui est contraint à l'exil en 1962. Le MESAN devient alors parti unique, et son hégémonie sur l'appareil d'État est institutionnalisée par une nouvelle Constitution adoptée en 1964. L'autoritarisme de David Dacko et les maigres résultats qu'il obtient sur le plan économique le rendent impopulaire. Son rapprochement avec la Chine communiste inquiète la France.
Ascension et chute de Jean Bédel Bokassa (1965-1979)
La nuit de la Saint-Sylvestre 1965, un coup d'État renverse Dacko. Il est conduit par le colonel Jean Bédel Bokassa, chef d'état-major, ancien sous-officier devenu capitaine dans l'armée française, et qui a participé à la libération de la France en 1944 avant de servir en Indochine. Personnalité déroutante, imprévisible et capable de toutes les excentricités, Bokassa n'est pas dépourvu d'un certain charisme ainsi que de sens politique. Malgré l'incohérence de ses décisions et sa cruauté, il parvient à se maintenir près de 14 années au pouvoir, faisant pression avec succès sur la France en jouant d'alliances momentanées avec l'URSS, les pays de l'Est, la Corée du Nord et, même, la Libye, se convertissant à cette occasion à l'islam pendant quelques mois. Il menace aussi Paris de créer sa propre monnaie.
À partir de 1970, sa « progression » est fulgurante : président à vie en 1972, maréchal en 1974, empereur en 1976. En contrepoint, les tentatives de coup d'État se multiplient. Mais Bokassa Ier, qui a installé sa cour dans son palais de Bérengo, dans son pays natal, alors que le gouvernement demeure à Bangui, finit par lasser de nombreux chefs d'État africains, puis le gouvernement français lui-même. La coupe déborde en 1979, lorsqu'on apprend, de la bouche de l'ambassadeur impérial à Paris, démissionnaire, que plus de 100 lycéens emprisonnés à la suite de manifestations sont morts sous les coups de leurs gardiens. En septembre, à l'occasion d'un déplacement de Bokassa à Tripoli, un détachement militaire français s'empare de Bangui et de Bérengo et réinstalle David Dacko au pouvoir.
La restauration manquée
Toutefois, David Dacko ne réussit pas à se maintenir longtemps à la tête de l'État. Il a pourtant transformé le MESAN en UDC (Union démocratique centrafricaine), puis instauré le multipartisme, fait adopter, par référendum, une nouvelle Constitution (le 1er février 1981) et, enfin, il s'est soumis au verdict des urnes, à l'occasion de l'élection présidentielle réellement pluraliste du 15 mars, ce qui, à l'époque, est rare en Afrique. Mais sa courte victoire (50,2 % des voix, devant Ange-Félix Patassé, ancien ministre de Bokassa) est contestée par l'opposition, et la situation économique, peu brillante, est à l'origine de tensions sociales. Il est déposé par le général André Kolingba, le 1er septembre 1981, au terme d'un coup d'État militaire.
La Constitution et les activités des partis politiques sont suspendues, et un Comité militaire de redressement national (CMRN) est mis en place. Une tentative de reconquête du pays par A.-F. Patassé (1982) donne lieu à des manifestations quasi insurrectionnelles, vigoureusement réprimées, et A.-F. Patassé doit s'exiler. André Kolingba, à partir de 1985, « civilise » son régime. Le CMRN cède la place à un gouvernement (dans lequel les militaires restent toutefois majoritaires), un référendum-plébiscite est organisé (novembre 1986) : une nouvelle Constitution est approuvée, qui fait du Rassemblement démocratique centrafricain (RDC), nouvellement créé, le parti unique, et confirme le général dans ses fonctions.
L'échec de la démocratisation
En 1990, la situation économique est toujours aussi médiocre, et la politique d'austérité préconisée par le Fonds monétaire internationale (FMI), de plus en plus impopulaire. Le « vent d'est » qui souffle en Afrique depuis la chute du mur de Berlin ne fait, par ailleurs, qu'attiser les mécontentements. À Bangui, une manifestation organisée en octobre par la coordination de l'opposition tourne à l'émeute. Avec beaucoup de mauvaise volonté, le général Kolingba cède aux revendications, sous la pression de la France. Lors de l'élection présidentielle d'août-septembre 1993, Kolingba et Dacko sont éliminés au premier tour, et A.-F. Patassé l'emporte finalement sur Abel Goumba. L'occasion de renouveler le personnel politique n'a pas été saisie.
D'une tutelle à l'autre
Le retour à la normale dure peu. En 1996, trois mutineries militaires ébranlent le régime, qui ne doit son salut qu'aux interventions des troupes françaises. En mars 1998, le gouvernement, l'opposition et les insurgés signent sous la pression internationale un pacte de réconciliation nationale. Entre-temps, la France, qui ne veut plus jouer son traditionnel rôle de gendarme, se fait relayer (février 1997) par une force interafricaine dont elle assure le soutien logistique – la Misab (Mission d'intervention et de surveillance des accords de Bangui) – placée sous l'autorité de l'ONU. Bien qu'ayant fait preuve, à plusieurs reprises, de brutalité dans la répression, elle voit son mandat prolongé jusqu'au 15 mars 1998. Dans le même temps, le gouvernement français annonce la fermeture progressive de sa base militaire de Bouar. La Misab est alors remplacée par la Minurca (Mission des Nations unies en République centrafricaine), force onusienne de 1 350 hommes, dont le mandat est prolongé jusqu'en décembre 1999. L'action de cette dernière est relayée par le Bonuca (Bureau des Nations unies pour la consolidation de la paix en République centrafricaine), mis en place en février 2000.
Des élections législatives se tiennent en novembre-décembre 1998 : elles sont remportées par une coalition de partis d'opposition qui obtient la majorité des sièges à l'Assemblée. Mais, grâce à la défection de l'une de ses composantes, qui rejoint le parti du président (le Mouvement pour la libération du peuple centrafricain [MLPC]), A.-F. Patassé peut nommer un de ses partisans au poste de Premier ministre ; ce dernier, après plusieurs tentatives infructueuses, réussit à constituer un gouvernement (mi-janvier 1999).
La situation politique reste cependant confuse, l'opposition manifestant ouvertement son mécontentement devant ce qu'elle considère comme une manœuvre de A.-F. Patassé pour se maintenir au pouvoir. En octobre 1999, celui-ci parvient à se faire réélire dès le premier tour (recueillant 51,6 % des voix, contre 19,3 % à son principal rival, l'ancien président A. Kolingba).
Dans la nuit du 27 au 28 mai 2001, des mutins encerclent la résidence du chef de l'État à Bangui, mais sont repoussés par la garde présidentielle : selon les services de A.-F. Patassé, cette nouvelle tentative de coup d'État est fomentée par l'ex-président A. Kolingba (ce dernier sera condamné à mort par contumace en août 2002). Le couvre-feu est décrété et l'armée centrafricaine, appuyée par une centaine de Libyens et des rebelles du Mouvement de libération du Congo (MLC) de Jean-Pierre Bemba, entreprend dans les jours qui suivent une « chasse aux Yakomas », l'ethnie minoritaire du général-président Kolingba, qui s'enfuit vers l'Ouganda.
Également impliqué dans ce putsch manqué, le chef d'état-major des armées, le général François Bozizé, est limogé le 26 octobre suivant. Quelques jours après son limogeage, il rallie à sa cause plusieurs dizaines de militaires, qui s'opposent par les armes à son arrestation. La situation reste confuse dans le nord du pays, à la frontière avec le Tchad, où l'ex-général F. Bozizé et ses fidèles ont trouvé refuge.
Lancée par ces derniers le 25 octobre 2002, une nouvelle tentative de coup d'État dans la capitale, au cours de laquelle 150 civils tchadiens trouvent la mort, provoque une crise entre le Tchad et la République centrafricaine. La garde présidentielle, soutenue par les miliciens du MLC, repousse les insurgés. Mais, le 16 mars 2003, alors que le chef de l'État s'est absenté pour participer à un sommet régional à Niamey, l'ex-général F. Bozizé s'empare du pouvoir avec l'aide du Tchad. La participation de la République centrafricaine au sein de l'Union africaine est suspendue.
Le général François Bozizé (2003-2013)
Autoproclamé président de la République, François Bozizé suspend la Constitution et dissout les institutions pour une période de « transition consensuelle ». Tous les partis politiques – y compris celui du président déchu, A.-F. Patassé, en exil au Togo, – se disent prêts à collaborer avec le nouveau régime.
Un premier gouvernement de transition, formé en avril 2003 et dirigé par A. Goumba, opposant historique et intègre, ne résiste pas à une vague de mécontentement social (les caisses de l'État sont vides, les fonctionnaires ne sont pas payés à échéance et les appels à la grève se multiplient). Il est remplacé, en décembre 2003, par un nouveau gouvernement d'union nationale que dirige Célestin Gaombalet. La Force multinationale en Centrafrique (Fomuc), mise en place depuis octobre 2002 par la Communauté économique et monétaire d’Afrique centrale (CEMAC), joue un rôle prépondérant dans le rétablissement des conditions de sécurité suffisantes pour permettre des élections.
En décembre 2004, une nouvelle Constitution, fixant le mandat présidentiel à 5 ans et renforçant le pouvoir du Premier ministre, est approuvée par référendum.
Onze candidats participent à l'élection présidentielle du printemps 2005, censée, avec le scrutin législatif du même jour, mettre un terme à la période de transition ouverte le 16 mars 2003 par le coup d'État du général Bozizé. Ce dernier remporte le scrutin avec 64,6 % des voix devant Martin Ziguélé, ex-Premier ministre de l'ancien président A.-F. Patassé (2001-2003) et candidat du Mouvement pour la libération du peuple centraficain (35,4 %). Moins attendue, la victoire au scrutin législatif de la Convergence nationale Kwa na Kwa (« le travail, rien que le travail »), réunissant les partisans de F. Bozizé, permet à ce dernier de choisir un Premier ministre, Élie Doté, parmi les siens. La RCA réintègre l'Union africaine en juillet 2005.
En 2006, la situation se détériore avec l'apparition d'une nouvelle rébellion dans le nord-ouest du pays. Partis du Sud-Darfour et regroupés au sein de l'Union des forces démocratiques pour le rassemblement (UFDR), les rebelles – aux revendications hétéroclites – s'emparent de plusieurs localités de la région, dont Birao, à l'automne 2006, avec l'intention de renverser le régime. Ils sont arrêtés par les forces armées centrafricaines, soutenues par l'armée française, qui reprennent rapidement le contrôle de la région, non sans infliger aux populations civiles locales de lourds dommages. Depuis, le président Bozizé prône le dialogue avec la rébellion, mais, en dépit des accords de Syrte et de Birao (février et avril 2007), le cessez-le-feu conclu avec l'UFDR demeure précaire et le dialogue peine à s'instaurer. La région du Nord-Ouest, victime d'une situation humanitaire difficile (200 000 personnes déplacées) subit, en outre, les conséquences de la crise du Darfour et notamment l'afflux de réfugiés fuyant les combats. À partir de février, le déploiement au Tchad et en RCA de la force européenne Eufor permet aux autorités centrafricaines d'espérer un arrêt des incursions rebelles et une diminution de l'afflux des réfugiés.
Le début de l'année 2008 voit la mise en œuvre d'un processus de dialogue politique inclusif (DPI) visant à la réintégration des mouvements de rébellion armés et à leur transformation en partis politiques. Un accord de paix global est signé à Libreville entre le gouvernement, l'Armée populaire pour la restauration de la démocratie (APRD) et l'UFDR. Après plusieurs mois d'atermoiements, gouvernement, partis politiques, ex-rebelles, syndicats et représentants de la société civile, réunis en forum du 8 au 20 décembre 2008 sous le parrainage du président gabonais Omar Bongo Ondimba, parviennent à s'entendre sur la création d'une Commission vérité et réconciliation et la mise en œuvre d'un processus de désarmement, de démobilisation et de réinsertion (DDR) des ex-rebelles. Très lent et soumis à de nombreux blocages, ce processus est retardé par des rivalités ethnico-économiques dans la région des trois frontières (Centrafrique, Tchad et Soudan).
Aboutissement du dialogue national qui a rassemblé en 2008 pouvoir, opposition et rébellions, l'élection présidentielle se déroule le 23 janvier 2011. François Bozizé est réélu dès le premier tour avec 66,1 % des suffrages devant Ange-Félix Patassé (20,10 %) qui décède en avril, et l'ex-Premier ministre Martin Ziguélé (6,46 %).
Ce dernier, ainsi que deux autres candidats de l’opposition dont l’ex-chef de l’APRD, dénoncent la fraude et demandent l’invalidation d’un scrutin avalisé par certains observateurs internationaux alors que la mouvance présidentielle Kwa na Kwa arrive également en tête des élections législatives. La réélection de François Bozizé, qui se présente comme un pacificateur, n’est cependant pas remise en cause par la communauté internationale, dont la France qui soutient le processus de transition et les « efforts de bonne gouvernance » du régime. Celle-ci est toutefois encore loin d’être acquise, notamment en matière de gestion du secteur minier du pays, principal atout économique du pays, l’exploitation du diamant notamment étant encore très opaque et désorganisée.
La stabilisation politique reste ainsi fragile et la situation sanitaire extrêmement précaire. Si deux factions de la dernière grande rébellion centrafricaine, la Convention des patriotes pour la justice et la paix (CPJP), acceptent d’intégrer le processus de paix en juin et août 2011, et si 4 000 ex-combattants, pour la plupart de l’APRD, ont été démobilisés depuis le mois de juin dans le nord-ouest du pays, le gouvernement doit aussi faire face au banditisme d’anciens rebelles, qui entraîne d’importants déplacements de population dans le Nord, aux exactions de la LRA (Armée de la résistance du Seigneur) de Joseph Kony (pourchassé en Ouganda) et présente dans le Sud-Est et l'Est, ainsi qu’aux incursions d’un groupe tchadien, conduit par Baba-Laddé, dans le nord-ouest du pays.
10. La République centrafricaine après la chute de F. Bozizé (2013-)
La situation politique se dégrade au cours de l’année 2012 : des factions rebelles issues des différents mouvements de rébellion (CPJP, UFDR) ou récemment constituées (Convention patriotique du salut du Kodro, CPSK) reprennent les armes et exigent le respect des accords de paix signés en 2007 et 2008 mais restés lettre morte. Réunies au sein de la Séléka (« Coalition » en sango), elles parviennent à se rendre maîtres des trois quarts du territoire après une offensive lancée à partir du nord du pays et à laquelle participent des rebelles étrangers soudanais et tchadiens.
Malgré l’appui militaire consenti par le Tchad et la présence de la Force multinationale d’Afrique centrale (FOMAC, qui a remplacé la Fomuc en 2008) – la France refusant de son côté de soutenir le régime moribond –, les Forces armées centrafricaines, affaiblies par des mutineries et désorganisés, doivent céder face à l’offensive lancée en direction de la capitale Bangui au mois de décembre. Un accord de dernière chance est obtenu à Libreville en janvier 2013 avec la formation d’un gouvernement d’union nationale mais, fortes de leurs succès militaires, les forces rebelles entrent à Bangui les 23-24 mars d’où s’est enfui F. Bozizé, finalement lâché par son allié tchadien.
Michel Djotodia, chef de l’UFDR et de la Séléka s’autoproclame président et maintient Nicolas Tiangaye (nommé en janvier) au poste de Premier ministre. Une transition à la durée indéterminée avant l’organisation de nouvelles élections est annoncée.
L’intervention française et internationale
La victoire de la rébellion donne bientôt lieu à des exactions commises par des bataillons incontrôlés contre la population civile, victime de tueries, de viols et de pillages. Les autorités se montrant incapables de rétablir la paix en dépit de la dissolution de la Séléka, le pays sombre dans le chaos.
Les risques de déstabilisation que ferait peser sur l’ensemble de la région la création d’une zone grise devenant le refuge de groupes terroristes et criminels alertent l’Union africaine et les Nations unies qui décident d’intervenir avec l’aide militaire de la France.
À la suite de l’adoption par le Conseil de sécurité de la résolution 2127 (5 décembre) l’opération française « Sangaris » est alors déclenchée pour appuyer les troupes de la Mission internationale de soutien à la Centrafrique sous conduite africaine. Cette intervention militaire – à laquelle s’associe par la suite l’UE – s’avère incertaine et périlleuse. Malgré les appels au calme et au dialogue lancés par les autorités religieuses du pays, la situation menace en effet de dégénérer en conflit entre musulmans identifiés ou associés aux ex-rebelles de la Séléka et chrétiens organisés en milices d’autodéfense (les « anti-balaka ») parfois appuyées par des soldats de l’ancienne armée nationale.
Dépourvu de toute autorité, M. Djotodia est finalement forcé à démissionner le 10 janvier 2014. Alors que les tueries, dont la minorité musulmane est désormais la première victime, et les représailles qui s’ensuivent se poursuivent, le Parlement provisoire élit comme présidente de transition, Catherine Samba-Panza, maire de Bangui, le 20 janvier. À André Nzapayeké, nommé Premier ministre, succède Mahamat Kamoun en août.
L’ONU, qui évoque un risque de génocide et de crise alimentaire majeure, estime à 886 000, dont plus de 500 000 à Bangui, le nombre de personnes déplacées et lance un appel à une aide humanitaire d’urgence.